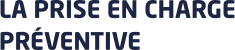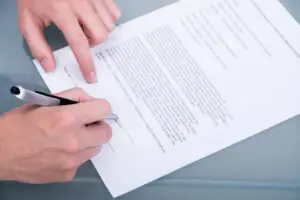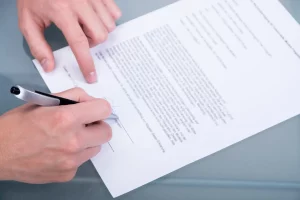Les sciences comportementales ont un impact grandissant sur les politiques publiques. Mais nous n’en sommes encore qu’aux balbutiements et ces politiques sont encore limitées et immatures. Le rapport « Unlocking the Full Potential of Behavioural Insights for Policy » du Centre Commun de Recherche (JRC) de la Commission européenne explore comment les sciences comportementales peuvent transformer les politiques publiques, notamment en matière de santé et de santé numérique. Mais ces approches sont-elles réellement efficaces ? S’attaquent-elles aux racines des problèmes ou ne font-elles qu’en atténuer les symptômes ? Analyse critique.
L’Impact des sciences comportementales sur les comportements santé
Le rapport met en avant l’utilisation des interventions comportementales (nudges, boosts, information ciblée) pour orienter les choix des individus vers des comportements plus sains. Deux limites sont toutefois notées :
- L’accent mis sur le comportement individuel comme un choix et non un contexte
Par exemple, l’affichage des calories sur les menus vise à influencer les décisions alimentaires. Toutefois, ces approches ne s’attaquent qu’aux manifestations du problème sans modifier les causes profondes de l’obésité, comme la précarité alimentaire ou l’accessibilité aux produits sains.
- L’efficacité limitée des mesures actuelles, centrées sur les nudges.
L’impact des nudges sur la durée est souvent marginal. Certaines études citées dans le rapport montrent qu’une intervention peut être efficace sur le court terme, mais que son effet diminue avec le temps si elle n’est pas accompagnée de mesures structurelles. Par exemple, inciter à manger plus de légumes via des campagnes de sensibilisation fonctionne mieux si elle est couplée à une politique de subvention des produits frais ou à une réglementation sur les additifs alimentaires.
- L’intégration « plug-in » des politiques de comportements santé à des politiques existantes, plutôt que des politiques intégrées.
Une définition réductrice des comportements santé ?
Une des limites du rapport réside dans sa conception des comportements santé. Il semble les appréhender uniquement sous l’angle de la prise de décision individuelle, en oubliant les déterminants sociaux et économiques qui influencent profondément ces choix. L’exemple de la taxation du tabac illustre cette lacune : si elle réduit la consommation chez certains, elle peut aussi renforcer les inégalités, car les populations précaires ont plus de difficultés à arrêter de fumer faute d’accès à des solutions adaptées (accompagnement psychologique, substituts nicotiniques abordables, etc.).
Cette vision « individualiste » peut être problématique car elle peut conduire à des politiques inefficaces, voire contre-productives, en culpabilisant l’individu sans modifier l’environnement qui conditionne ses choix.
Santé numérique : entre potentiel et défi de l’acceptabilité
Le rapport explore aussi la santé numérique, en mettant en avant le rôle des outils technologiques pour améliorer les comportements santé : applications de suivi, téléconsultations, rappels médicaux automatisés… Bien que prometteurs, ces dispositifs ne peuvent fonctionner sans une adhésion forte du public. Or, la méfiance envers le numérique dans la santé demeure élevée. La multiplication des solutions souvent similaires, poussées par des acteurs publics, rajoute encore une complexité à l’adhésion.
Le rapport préconise des stratégies de communication et de transparence pour favoriser l’adoption de ces outils. Mais là encore, si les nudges peuvent inciter à télécharger une application de suivi médical, ils ne suffisent pas à assurer une adoption durable si des garanties structurelles (sécurité des données, accessibilité financière, formation des professionnels de santé) ne sont pas mises en place.
Une cohérence des politiques mise à l’épreuve
Enfin, le rapport met en avant l’intégration des sciences comportementales dans différentes politiques, mais leur cohérence globale reste discutable. Par exemple, les politiques agricoles européennes subventionnent encore des pratiques qui favorisent une alimentation ultra-transformée, alors que d’autres directives encouragent les citoyens à manger plus sainement. Cette dissonance réduit l’efficacité des interventions comportementales, qui se retrouvent en conflit avec d’autres dynamiques économiques et réglementaires.
Conclusion : un outil à double tranchant
Les sciences comportementales offrent des leviers intéressants pour améliorer les politiques de santé, notamment en facilitant l’adoption de comportements bénéfiques. Cependant, leur efficacité est conditionnée par leur intégration dans un cadre plus large, qui prend en compte les déterminants socio-économiques et la cohérence entre les différentes politiques publiques.
En l’état, ces interventions comportementales apparaissent souvent comme des rustines appliquées à des systèmes défaillants plutôt que comme des solutions durables. Pour qu’elles soient réellement efficaces, elles doivent être complémentaires à des réformes structurelles, et non s’y substituer.
Ainsi, la question reste ouverte : les sciences comportementales vont-elles devenir un outil de transformation profonde des politiques publiques ou rester de simples ajustements cosmétiques ?
Sources:
Rapport « Unlocking the Full Potential of Behavioural Insights for Policy » du Centre Commun de Recherche (JRC) de la Commission européenne : https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC138028